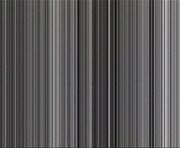Archéologie de l'architecture, de l'enfance, de l'histoire, du corps, des temps
1998 - 2005
Lamento
Lamento est un recueil de cinq textes tirés de l'ouvrage du même nom, édité par le Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean, (Mudam Luxembourg), à l'occasion de l'acquisition du Musée des trois sculptures de Pascal Convert autour de la question de la photographie de presse.
"Construire la durée" / "Constructing duration" / "Die Konstruktion der dauer" Georges Didi-Huberman
"Pascal Convert ou comment se dépêtrer du réel" / "Pascal Convert or how to get free of the real" /
"Pascal Convert oder wie man sich von der wirklichkeit befreit" Catherine Millet
"Images passages" / "Passageway images" / "Durchgangsbilder" Pascal Convert
"Eloge des aérolithes" / "In praise of aeroliths" / "Lobrede auf due himmelssteine" Philippe Dagen
"L'orphelinat des images",
Pascal Convert, l'homme de l'art effaré
par Bernard Stiegler
"Et l'Infini terrible effara ton oeil bleu!"
Rimbaud
Pascal Convert montre le circuit que fait une image à travers lui, et il tente de nous introduire dans ce circuit, qui est lui-même inscrit dans un processus (et pris et constitué par lui) où se forment, se dé-forment et se trans-forment les échanges symboliques par où se trame notre histoire : où nous sommes déjà pris.
Le processus où une image circule est celui d’une individuation psychique et collective. L’artiste opère dans ce processus des prélèvements, des projections et des ouvertures, qu’il œuvre et qu’il ouvrage précisément entre le psychique et le collectif. Œuvrant, il montre comment l’individuation qu’est tout affect psychique, comme trans-formation ou dé-formation de celui ou de celle qui s’individue, affect dont l’expérience d’une image quelconque (pieuse, d’actualité ou artistique) est un cas, cette individuation psychique est inscrite dans et constituée par le processus d’individuation collective qui la soutient et qu’elle soutient.
Le psychique ne précéde pas le collectif, ni l’inverse : cette conjonction d’emblée psychosociale est ce qui constitue une relation que Simondon dit transductive, c’est à dire telle que les termes de la relation sont constitués par la relation, l’un ne pouvant exister sans l’autre.
Voyant une image, je m’individue (c’est ce que signifie voir) ; ou bien je ne la vois pas, ou bien encore, je me désindividue, c’est à dire que la regardant j’en deviens aveugle, ce qui est un cas limite de l’individuation, et aussi, et surtout, la question même de notre temps (1): c’est cette question qui affecte Convert, qu’il appelle l’orphelinat des images – et qui lui fait se demander, devant la Piéta du Kosovo : « Qu’est-ce que tu fais, toi ? »
Voyant une image, de nos jours, je m’individue ou je me désindividue à l’intérieur d’un processus d’individuation (qui est aussi devenu, pour notre malheur, un processus de désindividuation), dont cette image, justement, est une image : un révélateur, une imago en ce sens. Ce processus, dans les pays du monde occidental, est celui de l’histoire de l’Occident qu’est l’histoire du monothéisme (dont l’Islam, à cet égard, est le bord oriental et méridional, la ceinture méditerranéenne, et la région limitrophe de l’Asie : l’Islam est l’Occident, c’est le côté oriental de l’Occident). Jamais ne m’affecte une image hors d’une telle affection historique, qui me dé-borde, et qui, par nature, m’échappe.
Cet échappement débordant, qui donne ce que Blanchot nomme « le vertige de l’arrachement », et qui est le flux du temps et son ressac, et comme le battement de l’horloge historique même (l’échappement est le principe du fonctionnement mécanique de l’horloge), est précisément cet affect lui-même, en tant qu’il engendre le processus d’une résonance interne dans le processus d’individuation collective, et comme ce tremblement par où le collectif non seulement devient, mais advient, et par où, avec lui, les individus psychiques deviennent ce qu’ils sont précisément comme singularités advenues et transductivement constituées.
Or, ces singularités transductives sont para-doxales (en marge de toute doxa, et en cela inattendues), puisque étant singulières, c’est à dire incomparables les unes aux autres, elles sont cependant constituées par la relation où elles se forment, en tant que termes de cette relation, qui les constitue précisément tels que ces termes que voici, chacun étant incomparable dans la relation même qui le relie aux autres en tant qu’il s’individue. C’est la raison pour laquelle Simondon définit cette relation comme une tension – c’est à dire, tout aussi bien, comme un affect. Et comme l’affect d’un processus d’individuation par nature inachevé (dont la tension ne peut être résolue qu’au prix de la destruction du processus d’individuation lui-même) et en cela in-fini.
Bref, la transduction est cette très étrange relation qui relie des choses qui sont incomparables – qui ne peuvent donc pas être reliées. Autrement dit, la transduction est une dynamique : ce n’est pas une relation statique, et c’est la conséquence immédiate de l’inachèvement intrinsèque du processus d’individuation (lorsqu’il est achevé, il n’y a justement plus d’individuation).
Cette dynamique et son étrangeté forment une sorte de mystère, qui conduit par exemple Simondon à poser qu’il n’est pas possible de décrire l’individuation sans contribuer à l’individuer, sans la trans-former, sans faire autrement dit que ce qui a été décrit a été changé par le fait d’être décrit et par là même n’aura donc pas été décrit, sinon comme un stade déjà révolu : il n’est pas possible de connaître l’individuation (et c’est bien là ce que l’on appelle un mystère).
Un tel mystère est celui du mysticisme. C’est aussi celui de l’art. C’est le mystère de la transindividuation dont la transfiguration est un nom théologico-métaphysique, mais qui hante toute figuration, au moins en Occident.
Par excellence, l’œuvre de l’art est ce qui intensifie cette relation (cet affect) en tant qu’il en résulte une individuation à la fois psychique et collective, c’est à dire une affirmation des singularités qu’elle relie, plutôt que leur désinviduation (plutôt que leur particularisation d’anonymes comparables). L’artiste est par excellence celui qui s’individue en sorte que ce qui l’affecte psychiquement intensifie et accélère l’individuation collective de ses contemporains par l’art et la manière qu’il a de rendre mystérieusement cet affect à ce dont il provient, à savoir le fonds préindividuel du psychosocial.
Ce fonds préinvididuel, c’est ce dont héritent les individus psychiques (les je) qui par là même forment un nous (un individu collectif, qui est un processus dynamique sans cesse brassant de nouveaux individus, les adoptant par les échanges symboliques dont il est le siège) à travers des organisations symboliques transgénérationnelles, telles que les langues, les religions, les codes juridiques, les artefacts en général – dont les œuvres elles-mêmes, celles de l’art tout aussi bien que celles de l’esprit.
Tel qu’il le rend en le trans-formant, l’artiste transindividue le processus d’individuation, et le fait advenir, précisément en cela, et par excellence, comme psychique et collectif, et d’un seul tenant, en quelque sorte. Et il en va ainsi parce que l’individuation de l’artiste qui s’individue à travers ce qu’ouvre son œuvre est aussi et toujours déjà, au-delà de son étroite psyché, ce qui s’y mire comme le paysage effarant et infini du temps – qui est le puits sans fond ni origine de l’individuation, de son flux, de son reflux, de ses ressacs.
Mais ce mirage est une trans-formation – une individuation comme temporalisation qui s’ouvre en œuvrant et ouvrageant l’espace du processus d’individuation – : agent d’une transindividuation, l’artiste est un transducteur du processus d’individuation, et c’est ainsi que nous regarde le travail de Pascal Convert.
« Une image nous survit », dit-il, et cela signifie qu’une image étaye le fonds préindividuel du processus auquel elle appartient, et qui pré-cède l’individuation psychique et l’individuation sociale comme ce qui, leur étant commun, les relie et les sépare tout à la fois, et constitue en cela la condition de leur relation transductive, de leur trans-ductivité. Car les images sont entre les singularités qui s’y mirent comme l’espace et le temps de leur rencontre telle qu’elle demeure toujours à venir.
J’appelle ici « image » tout objet provenant, et, si j’ose dire, provenu du fonds préindividuel – telle une souche arrachée de Verdun – dans la mesure précisément où chaque objet n’objecte au sujet que ce que celui-ci peut y mirer.
C’est depuis la pensée et l’expérience de ce fait de la sur-vivance qu’œuvre Convert. Sur-vivance qui est une sur-mortalité : un dépassement, sans dieu – pour nous qui vivons encore après la mort de Dieu – , de l’opposition de la vie et de la mort, c’est à dire du mort et du vif.
Telle est la question.
L’image mentale aura toujours constitué l’imaginaire, mais il n’y aura jamais eu d’image mentale sans image-objet – et c’est en ce sens, sur ce fonds originaire de la survivance, que, dans le monde occidental christianisé, l’image se sera en fin de compte constituée en histoire de l’art, ce qui veut inévitablement dire, ici, en histoire de l’art chrétien. Non pas qu’il n’y aurait d’expérience de l’art que chrétienne, mais dans la mesure même où la grande partition de la forme et de la matière, opérée par la métaphysique grecque dès Platon, et qui conduit celui-ci à opposer le corps et l’âme, est aussi ce qui organise la réception paulinienne de ces questions de l’âme et du corps, c’est à dire de la vie et de la mort, jusque de nos jours, où nous pensons encore ainsi, en « pauliniens » (c’est à dire en opposant l’esprit et la matière). C’est depuis le fonds préindividuel des images divines, et divines précisément en tant qu’elles projettent et organisent ces oppositions (précisément en tant que toutes sont issues en cela du monothéisme comme ce qui oppose l’âme et le corps, c’est à dire la vie et la mort), que l’art se sera conçu lui-même comme un art, c’est à dire comme une histoire.
Or, il en est d’une telle partition comme d’un effarement quant au fait de la mort. Car il n’y a certes aucun accès à cet autre plan qu’est la mort accomplie, et où se tient le mort, et où se tiennent les morts, et dont le divin n’est qu’un nom, hors d’une expérience de l’inconcevabilité du décès, et de ce qui s’y constitue dès lors en excès : au-delà de la fatalité du fait, et comme sa né-cessité même.
C’est dans le réseau, et le filet, et en quelque sorte le piège de ces questions, telles qu’elles se lient de façon inextricable, et nous affectent du fait même de cette intrication, et comme un dédale, que Pascal Convert travaille en reliant images religieuses et images de télévision.
La Piéta du Kosovo, dit-il, est la photographie de presse d’un rite musulman que nous voyons comme chrétien. C’est là, de fait, la structure même de l’intentionnalité, telle que la phénoménologie fait apparaître que tout ce qui advient à une conscience procède de cette conscience, que celle-ci ne trouve ce qui lui arrive qu’en elle-même, comme étant son déjà-là. Mais ce déjà-là, nous dirons avec Simondon qu’il constitue un processus d’individuation psychique et collective, et que ce et est ce qui ouvre le soi – ce qui veut dire aussi qu’il ne s’agit plus simplement de la conscience, mais bien de l’inconscient.
Dans le cas de ce rite musulman que nous voyons comme chrétien se posent deux questions à la fois : celle du fait que ce que nous y voyons, c’est nous qui l’y projetons ; mais aussi celle du fait que cette projection révèle une souche commune à l’islam et au christianisme, et leur appartenance lointaine mais d’autant plus profonde à un même processus d’individuation psychosociale, cette racine fût-elle calcinée et en quelque sorte foudroyée par la colère de Dieu, comme les souches que Convert déterre des anciens champs de bataille de la première guerre mondiale.
Quant à la structure de l’intentionnalité, elle tient à ce fait que ce que je suis en train de dire au lecteur de ces lignes, c’est lui qui le dit : tout ce que j’écris, mon lecteur l’invente en ce sens où l’on parlait autrefois de l’invention de la Sainte Croix : il le (re)trouve en lui. J’attends tout ce qui m’arrive – et en même temps, cela m’advient comme l’inattendu même, et par accident : par un artefact, un art, cet art qui fait dire à Proust que le travail de l’écrivain ne consiste qu’à permettre à son lecteur de lire en lui-même. Il y a, autrement dit, des attentes enfouies, enterrées, et en cela inattendues, refoulées, réprimées, parce qu’il y a de la répression collective, c’est à dire des trauma originaires qui induisent des mécanismes de refoulements transindividuels. Et l'œuvre - de Proust ou de Convert – est ce qui ouvre, excave, déterre tout cela, et ce qui, en cela, suspend un fonctionnement, interrompt l’identité à soi d’une individuation, exhume ce soi comme un autre tout contre lui-même, c’est à dire comme une singularité, plus riche que toute identité.
Le soi est un horizon d’attentes inattendues, constitué de proto-attentes et d’archi-attentes et de l’inattendu qui les tend, car une attente est une tension, toute tendue, et cependant parfois très tendre (généreuse). Cet inattendu qui les bande donne l’énergie de l’individuation psychique aussi bien que collective : l’énergie d’un soi qui s’investit dans des circuits. Telle est la condition a priori – ou « effroyablement ancienne » (c’est encore Blanchot) – de possibilité de ce que Foucault appelle une « écriture de soi », conçue comme base du « gouvernement de soi et des autres ».
De tels « circuits », qui sont aussi ceux de ce que j’ai appelé l’exclamation (2), qui forment des boucles, ou, plus précisément, des spires, se forment aux conditions de ce que j’analyse comme des époques organologiques.
Or, il y a une époque où se lie tout à coup l’iconologie du monothéisme aux images de l’actualité télévisée, et c’est ce circuit, si singulier et si menaçant pour toutes singularités, que parcourt Pascal Convert.
Ces époques sont celles d’un processus d’individuation du sensible, c’est à dire du corps en relation avec d’autres corps, et par l’intermédiaire d’artefacts, qui donne des corps sociaux, et qui, en cela, symbolise. Ce processus, dans son déroulement, constitue, au fil de centaines de milliers d’années, une généalogie du sensible qui consiste en une succession de défonctionnalisations et de refonctionnalisations aussi bien des organes et appareils corporels, dont les organes des sens, que des techniques et des systèmes qu’elles forment, et, enfin, des organisations sociales, qui ne cessent de s’en trouver reconfigurées, ce que l’on appelle l’Histoire.
Tout ceci est déjà envisagé par Freud, quoique très succintement : il pose que la constitution de la libido passe par la station debout, racine de l’hominisation, et qui constitue elle-même une défonctionnalisation de l’odorat, et sa refonctionnalisation corrélativement à celle de l’organe de la vue. Freud nomme cela un refoulement organique.
Le problème est que Freud ne pense en rien la tekhnè dans cette affaire, ni donc que la circulation de l’énergie libidinale, sans laquelle il n’y aurait évidemment aucune énergie, suppose une technèse.
Les époques de cette organologie générale, où les rapports entre les corps animés, les artefacts et les organisations sociales ne cessent de se redéfinir et de se redistribuer, constituent des épisodes d’une histoire qui sont autant de katastrophai (au sens de dénouements) ouvrant sur de nouvelles époques. Mais quant à nous, nous vivons une katastrophè très singulière : elle constitue l’interruption du circuit lui-même, c’est à dire aussi bien la liquidation de l’économie libidinale et la désindividuation.
L’œuvre de Convert est cette souffrance, et comme celle de sa racine sous son tronc foudroyé. Il regarde les images, lui qui se dit orphelin des images, et il nous les rend, et nous montre que pour voir une image, il faut savoir la montrer : il faut savoir la rendre. Et la rendre au soi.
Etre orphelin des images, c’est être orphelin du monde, dit-il : rendre les images, c’est rendre le monde imaginable, et les rendre au monde où se peut le soi. Convert cherche le monde. Il cherche à rendre le monde au monde. C’est un artiste. Un homme de l’art. Et un homme effaré. C’est l’homme d’un art effaré.
Après une séance de cinéma, un concert, une pièce de théâtre, nous tous connaissons ce besoin d’extérioriser et de transmettre notre affection, notre être-affecté - et la contagion que cela induit aussi parfois, et comment cela peut tourner mal, suscitant le bavardage et refoulant l’affection en lieu et place de la dire, de l’ex-primer.
Ceci est une modalité de l’exclamation qui n’est possible que depuis la condition d’une extériorité technique et artefactuelle : il y a à l’origine de la généalogie du sensible un processus d’extériorisation qui constitue le fonds permanent et sans cesse reconfiguré de toutes les formes d’expression, c’est à dire aussi bien d’existence – car exister, c’est exprimer, c’est à dire aussi imprimer. C’est expérimenter.
L’artiste, du point de vue de cette pulsion exclamatoire, est littéralement hypertrophié. Et la politique est ce qui organise le circuit de ces exclamations. C’est ainsi que se constitue le processus de transindividuation – et en cela, l’horizon de l’homme de l’art est inexorablement politique : son destin politique est ce qui élève sa pulsion au plan du désir, et d’un désir sublime.
Qu’ouvre cependant une œuvre ? Et à quoi ? L’œuvre ne transmet pas un « contenu », mais une ex-périence qui est une épreuve, et en vue d’une correction d’épreuves en quelque sorte : une expérience en tant qu’elle reste toujours à venir. L’œuvre ouvre l’avenir. Un tel propos n’est-il pas banal ? Il le serait en effet si l’on n’en disait pas plus quant à la facture de cet avenir, quant à cette façon d’être de l’avenir qui s’ouvre à travers une œuvre, qui œuvre dans une œuvre.
L’œuvre ouvre un être-artiste, c’est à dire un mode d’être, et plus précisément, comme ouverture, elle est le passage à l’acte de cet être en tant qu’un mode d’existence où exister veut dire devenir, mais où le devenir doit se trans-former en à venir, c’est à dire en un soi. Le soi est l’ex-sistance (3) comme ex-périence, et l’œuvre y ouvre l’être artiste tout d’abord de l’artiste lui-même comme homme de l’art.
L’artiste qui œuvre s’ouvre, et s’il s’ouvre, c’est parce que sa tendance première, comme celle de nous tous, tous autant que nous sommes, et tels que nous ne sommes pas immédiatement ce que nous sommes, sa tendance première est de se fermer à ce qui en lui donne « des coups de boutoirs dans tous les sens », comme dit Artaud, et qui œuvre à travers nous tous en tant précisément que nous ne nous constituons qu’en constituant un tel « nous tous » - en puissance, sinon en acte. En droit, sinon en fait.
L’œuvre ouvre ensuite l’être-artiste de son destinataire, qui ne l’est, artiste, qu’en puissance, mais qui, lorsque il s’ouvre à l’œuvre, lorsqu’il est à l’œuvre ou à la manœuvre de s’ouvrir à l’œuvre, se trouve ouvert par elle à ce qui, en lui, convient à ce qui vint à l’artiste et de l’artiste à travers ce qu’ouvrit son œuvre. Ainsi ouvert, le destinataire passe à l’acte pour un temps, le temps de l’œuvre, et pour autant qu’elle l’affecte. Or, ce passage à l’acte est tout aussi bien une individuation à la fois psychique et collective du je qu’est le destinataire et du nous qu’il forme avec l’artiste et, à travers lui, avec le processus dont ils procèdent et où ils con-viennent.
La trans-mission que constitue un tel circuit de l’ouvert et dans l’ouvert, un circuit qu’il s’agit donc à chaque fois de creuser, de former, de percer, de conquérir et de trans-former, de faire passer à l’acte, c’est la transmission trans-gressive, c’est à dire trans-formatrice, d'une autonomie entendue comme la puissance et l’acte de se donner sa loi comme la loi même du soi. Bref, c’est l’épreuve et la preuve - mais toujours par défaut, et nous le savons depuis Kant – de la singularité.
La singularité est l’objet même du désir, et elle n’est pas simplement la différence : une différence n’est compréhensible que depuis une identité, par comparaison effectuée au sein de cette identité, tandis que le singulier est l’incomparable.
À l’époque de l’art effaré de Pascal Convert, cet objet du désir est structurellement menacé par l’actuel circuit organologique où l’énergie ne circule plus autrement que de façon explosive, assassine et terroriste, qu’il s’agisse de terrorismes d’Etats occidentaux ou de terrorismes de mouvements intégristes et clandestins, et c’est là le poison engendré par la perte d’individuation en quoi consistent les courts-circuits des images opérés par les médias du « capitalisme culturel ».
Tel est le fait de la guerre des images qui court-circuitent et explosent l’individuation, explosion qui est cependant aussi une auto-destruction du capitalisme, ou, comme le disait Derrida, sa maladie auto-immunitaire : cette misère symbolique est la débandade de l’énergie libidinale sans laquelle il n’y a aucun processus d’individuation, alors même que le capitalisme aura mis cette énergie au cœur de son fonctionnement, mais en sorte que, comme toutes les énergies qu’il capte, il finit par l’épuiser.
Bref, l’épreuve à l’œuvre est aujourd’hui l’enjeu d’un grand combat : le combat de la transindividuation qu’est la trans-formation de l’œuvrer comme transgression, et de sa reconfiguration à de nouvelles conditions organologiques où il s’agit d’inventer (de trouver), dans le soi, et en état d’urgence, une nouvelle organisation du sensible. Une nouvelle politique, tout aussi bien. Disons aussi un nouveau « partage du sensible ».
L’être-artistes-en puissance que nous serions tous, et chacun singulièrement, et le rôle de trans-figurateur que serait l'artiste en acte en tant que, dans un champ singulier du réel sensible, il serait celui qui a fait une certaine expérience, une certaine épreuve, comme certains ont fait un long voyage, un curriculum, un circuit, ce qui lui donne une autorité, celle de celui qui a une clé que personne d’autre ne possède, mais pour faire que d'autres fassent cette épreuve par eux mêmes, non pas en permanence, mais par intermittences, dans les intermittences où se forme et se trans-forme l’expérience des œuvres, cet être-artistes-en puissance que nous serions tous pour autant que nous adviendrions à l’œuvre s’apparente à ce qui constitue le travail de la psychanalyse, où le psychanalyste écoute ce qui travaille du côté de l’analysant, ne lui donnant qu’à faire l’épreuve de ce qui ne peut venir que de lui-même, en tant qu’il est aussi lui-l’autre, et tout effaré de cette altérité qu’il refoule.
Dans l’art de l’homme de l’art, cette épreuve est celle qui fait passer à l'acte ce que constitue, pour cet artiste-en-puissance tel que nous tous nous en sommes, tel(s) champ(s) de la sensibilité. Le passage à l’acte qu’est l’œuvre en tant qu’on la rencontre, à commencer par celui qui l’œuvre, l’artiste, est donc une ouverture, une trouée. L’œuvre désigne cette ouverture comme élargissement du sens, c’est à dire trans-formation du sensible, défonctionnalisation et refonctionnalisation du sens comme organe, et du sens comme sémiosis, et par contrecoups, c’est à dire par transindividuations, des artefacts et des organisations sociales, y compris les organes de télévision, ce qui constitue l’objet d’une organologie générale comme ensemble de circuits de transmissions.
Or, cette question se pose aujourd’hui singulièrement, et disons le, tragiquement, en cela que ce que j’ai analysé, avec Nicolas Donin, comme un tournant machinique de la sensibilité, engendre une perte de participation (esthétique, mais tout aussi bien politique), qui rompt les circuits, qui produit des court-circuits, et qui va bientôt mettre le feu par la destruction de la libido - c’est à dire par la libération des pulsions pures (la libido étant ce qui, liant ces pulsions, les rend impures, leur imposant sa composition).
Et en cela, il y a maladie du psychisme aujourd'hui – étant bien entendu que le psychisme est intrinsèquement malade : la psyché, c’est la maladie, c’est à dire le rapport au mal (au mauvais, au laid et au faux qu’est intrinsèquement le psychique).
C'est la maladie du psychisme qui en est la dynamique, c’est ce qui fait que le psychique ne cesse d’aller et venir entre le passage à l’acte et la régression à la puissance (4), entre l’élévation vers son motif, vers l’objet de son désir, et la régression vers les pulsions qui étayent ce motif.
Mais il faut prendre soin de cette maladie pour qu'elle devienne une santé, ce qui s’appelle une cure. Et toute cure est une sorte de culte, c’est à dire une pratique : la transindividuation en quoi consiste le circuit de l’individuation psychosociale suppose la règle d’une pratique, et c’est ici que s’établit la question de la participation.
J’ai largement développé ce point (5) en me référant à la fois à la question de la participation au divin qu’est pour Aristote le passage d’une âme noétique à son acte, là où elle s’ouvre, et à la théorie qui sous-tend cet énoncé de Leroi-Gourhan :
Il faut participer pour sentir.
Le religieux, le magique, le politique lui-même, l’art, la philosophie, le disciplines scientifiques, tout cela, et comme ce qui engendre des œuvres de l’esprit qui nous survivent et tout aussi bien nous précèdent, et nous ouvrent au processus de notre individuation psychosociale, ce sont des manières de prendre soin du psychique pour que le psychique, par des voies extrêmement variées, se réinvente et se trans-forme et par là se soigne lui même, comme chez les psychanalystes – mais comme social, et comme le social en tant qu’il fait corps pour autant qu’il œuvre. Et en tant que le psychique est aussi, ainsi, le collectif, ce soin est une politique (une participation à l’individuation d’un soi).
Ce n’est qu’ainsi que le psychique, et en tant que son destin est collectif, fait l'expérience d'une œuvre d'art : l’œuvre l’aide à s’ouvrir, c’est à dire à se soigner, à ne pas tomber définitivement malade de se fermer, épreuve par où il est renvoyé à soi, mais aussi au soi, c'est à dire à l'ouverture de soi en tant que ce soi n’est précisément pas son moi, en tant que le nous dé-borde toujours déjà le nous factuel et fini existant ici et maintenant (comme identité) dans le nous tous dont l’art est la promesse (la singularité).
L'œuvre ouvre à soi, et à un soi qui n'est pas le moi, mais qui est beaucoup plus ample, qui est inscrit dans l'individuation psychosociale, et cela, il faut le penser aujourd'hui en fonction de la maladie des institutions qui, en principe, doivent en prendre soin.
Par exemple, lorsqu’il m’est arrivé (au mois de janvier 2005) de lier essentiellement, à Téhéran, la mort de Dieu et la naissance de l’art moderne, soutenant qu’il ne pouvait y avoir une modernité de l’art que depuis que Dieu est mort, et plus généralement, lorsque je décris ce qui relie le destin de l'art contemporain et le capitalisme, la question sous-jacente est de savoir comment tout cela s'articule sur un dispositif qui relève de cette organologie générale dont j'ai déjà parlé en tant qu’elle constitue des circuits de transmission et de transindividuation, qui sont aussi ceux de l’énergie libidinale sublimée, et où se forme un soi qui rassemble les diverses modalités de toutes les formes de cure dans l’hallucination d’un même motif, d’un même moteur, d’un désir, autrement dit, de soi et du soi.
Cela, que j’appelle aussi la question des consistances et des sublimités, c’est ce qui, dans le nihilisme, fait absolument défaut, et c’est ce dont aujourd’hui nous devons prendre soin : apprendre à prendre soin, en constituant de nouveaux circuits, c’est à dire aussi bien des conjonctions et des disjonctions formant un nouveau tissu pour d’autres motifs – motifs signifiant aussi, et cela ne marche qu’en français, raisons, et c’est pourquoi est requise une nouvelle critique de la raison, mais d’une raison désormais toute tramée par la question du désir et de ses maladies, les pulsions, ce que nous pouvait pas encore penser Kant.
Les Exercices spirituels d'Ignace de Loyola disent la nécessité de faire par soi-même l'épreuve de la présence de Dieu contre une tendance à la régression qu’Ignace appelle le démon ou la tentation. Les Exercices sont un tel soin, et un écho tardif de l’écriture de soi par la pratique des hypomnémata. Dans les sociétés traditionnelles où il n’y a pas de religion révélée, un mythe d'origine suppose un rite d'initiation. Mais dans tous ces cas, il y a cure, c’est à dire soin pris aux âmes en tant que le mouvement des corps : en tant que leur désir. Dans les sociétés modernes, avec la psychanalyse, il faut que celui qui transmet (qui rend) soit passé par une épreuve qui l'a rendu apte à cette transmission, c'est à dire à faire en sorte que l'autre apprenne les ex-ercices (de exercere, mettre ou tenir en mouvement) sans que l'on se substitue à l'autre pour lui dire ce qu'il doit penser, et tel est précisément l’enjeu des exercices.
C’est tout aussi bien la base de la méthode socratique, et ce qui est vrai de la philosophie ainsi naissante est vrai, « toutes choses égales par ailleurs », dans le monothéisme, et en particulier, dans les figures religieuses exemplaires que sont les Saints. Car s’il faut faire les choses par soi même (« Qu’est-ce que tu fais, toi ? ») pour que s’ouvre un circuit – c’est un moment du circuit qui le constitue en tant que tel, et telles sont les techniques de soi qui reposent, dans les analyses de Foucault, sur les hypomnémata – , il y a des thérapeutiques, dont la religion est un cas, qui permettent de mutualiser, d'assister, de développer, avec les confesseurs et les autres figures des circuits du soi comme individuation psychosociale, une aide psychique, et il nous faut nous pencher, dès lors que nous réfléchissons à la transindividuation, et notamment en tant que l’art en est le foyer, sur une histoire du religieux (l’histoire de l’art étant celle de l’art religieux d’abord) comme une organisation de l'aide psychique qui est aussi une aide sociale, une aide à l’individuation comme socialisation.
Et il faut que nous l'examinions, aujourd'hui où le psychique est si gravement malade, comme question de la perte de participation esthétique, mais aussi, et indissociablement, de la perte de participation politique.
La maladie originelle du psychique, c'est sa mélancolie fondamentale (qui procède de son effarant défaut originaire d’origine : de sa technicité, de sa prothéticité, de sa facticité, etc.), c'est à dire sa capacité à être affectée par ces humeurs qui lui viennent finalement de sa mortalité (que je n’entende que ce que j’attends, et que je produise tout ce qui m’arrive, devient évident lorsque l’on est de mauvaise humeur et que, comme l’on dit, « on voit tout en noir »). Il y a cependant aujourd'hui des pathologies spécifiques qui viennent de ce que le désir, industriellement exploité comme énergie première du capitalisme mondial, a régressé au niveau du pulsionnel.
Lorsque la mélancolie, la bile noire, la mauvaise humeur s'empare de moi, c’est que mon énergie libidinale ne circule plus : je ne peux pas devenir ce que je suis, le soi ne peut plus passer à travers moi : « ça ne passe pas », je garde en travers de ma gorge quelque chose que parfois j’appelle étrangement mes glandes, dont je souffre, et qui m’étouffent.
Je ne m'individue plus, et du même coup, je n'individue plus le groupe : je suis hors circuit. Ou plus exactement, le groupe ne s'individue pas à travers moi, donc je ne m'individue pas. C'est ainsi que se distinguent le soi et le moi : le moi reste, il est là, mais il est vide, et d’autant plus lourd et présent par cette absence de soi.
Aujourd'hui se développent massivement des techniques industrielles de la captation des affects – dont l’un des grands théoriciens et praticiens fut Monteverdi : la musique des affects, qui est aussi une sorte de théorie des affects en musique, c'est une pratique de l'objet temporel musical, qui ne se pense certes pas comme tel (comme Zeit Objekt), mais qui comprend comment la temporalité musicale peut capter l'affect, pour le bloquer et en quelque sorte le fixer, ou pour le libérer. Dans la musique de Monteverdi, le processus libératoire fonctionne tout comme dans la musique religieuse, mais dans cet autre cas, c’est en relation avec le soin porté aux âmes par l’officiant qui les panse comme ses brebis, et l’on entrevoit ici l’ambiguïté qui constitue le fonds même de toutes ces questions : comment la cure peut conduire au troupeau.
Dans le cas des objets temporels audiovisuels et industriels, dont la télévision constitue un cas spécifique, il se produit tout à fait autre chose : on utilise la même puissance des objets temporels, mais cette fois-ci pour canaliser cette libido, de telle manière qu'elle ne peut plus faire soi, qu'elle me prive de moi, et qu'elle me déprend au sens où elle me rabat sur mon fonds pulsionnel : on vise d’emblée et exclusivement le devenir-troupeau.
Un objet temporel est un agrégat de rétentions primaires, au sens où la note d’une mélodie retient en elle la note qui la précède pour sonner comme cette note, et ce qui est ainsi retenu (la note précédente et passée) demeure présent dans ce qui le retient (la note présente), ce que Husserl nomme pour cette raison une rétention primaire. Cette agrégation primaire est effectuée par la conscience dont la mélodie est l’objet. Cette conscience est elle-même tramée par ses propres souvenirs, son expérience, qui constitue un tissu de rétentions secondaires. Et la conscience sélectionne dans les rétentions primaires en fonction de la teneur de ses rétentions secondaires : c’est la raison pour laquelle chaque conscience entend une musique différente de toute autre conscience dans une mélodie.
Or, il existe aussi des rétentions tertiaires, c’est à dire des formes objectivées de la mémoire collective, qui permettent d’agencer les jeux qui s’opèrent et qui œuvrent entre les rétentions primaires et les rétentions secondaires. Les rétentions tertiaires peuvent être tout aussi bien des œuvres de l’art ou de l’esprit que des émissions de radio ou de télévision. Quant à ces dernières, elles tendent à agencer les rétentions secondaires en sorte que toutes deviennent semblables, sinon identiques.
La technologie de contrôle qu’est la télévision procède par hégémonisation de l’accès aux rétentions tertiaires, en sorte que celles-ci permettent de standardiser les rétentions secondaires (celles-ci intériorisant les rétentions tertiaires de masse). Les œuvres de l’art tendent tout au contraire à intensifier la singularité des rétentions secondaires qui trament les individus psychiques comme échos de la singularité et de l’altérité celée dans les rétentions tertiaires qui trament elles-mêmes le potentiel préindividuel de l’individuation sociale.
Lorsque le soi perd la singularité de ce qui le trame, il devient de mauvaise humeur : il se sent se désindividuer. Il peut alors se perdre dans ce qui l’étourdit et le rend de plus mauvaise humeur encore – par exemple les images de télévision, dont le principe est aujourd’hui l’extension sans limite du populisme industriel.
La télévision est cependant le lot de l’individuation psychosociale contemporaine. Et il faut donc travailler le soi depuis les images qu’elle fait circuler, et qui créent ce court-circuit où le soi se perd dans sa mauvaise humeur. Tel est le travail de Convert, qui traque ce qui, dans ce court-circuit, procède pourtant des circuits longs qui trament l’individuation psychosociale de l’Occident des images.
Une œuvre vient à l’aide du soi en l’ouvrant, elle le sort de la mauvaise humeur où il se perd et n'est plus lui même – où, paradoxalement, il n'est plus lui même là même où il veut justement rester le même, s'accrocher à son identité, à ce moi qui s’en trouve par là même vidé, bloqué, im-puissant à s'individuer. Que nous percevions les choses depuis nos attentes, que nous produisions ce qui nous arrive, c'est ce que tout le monde sait lorsque, de mauvaise humeur, il voit tout en noir, et que le monde entier lui fait défaut et qu’il le hait. De cette expérience très ordinaire, il faut tirer cette leçon que le fait que je voies le monde en noir me rend encore plus de mauvaise humeur, et que je le vois encore plus en noir : la mauvaise humeur a la structure dynamique d’une telle spirale.
Les œuvres soignent ce genre de maladie, qui est le fonds de nos âmes, et que le capitalisme pulsionnel et le populisme industriel, sur lesquels les populismes politiques prolifèrent, exploitent désormais systématiquement, opérant un vaste court-circuit d’où surgit la grande panne de l’énergie libidinale. De ce court-circuit, Convert exhume le circuit long d’un fonds préindividuel qui précède la partition où, après la mort de Dieu, les images venues de ce culte qui interdit le culte des images disent la racine calcinée du processus d’individuation psychosocial occidental, dont l’islam télévisé donne les images effarées.
Un culte est ce qui organise des intentionnalités collectives, et il n’existe pas de sociétés sans de telles organisations. Après la mort de Dieu, la mémoire fait l’objet de nouveaux combats, pour d’autres organisations, que célèbre l’œuvre de Pascal Convert au mont Valérien. Le culte des morts, des héros, dont les œuvres sont des émissaires (et c’est le passage de l’héroïsme de l’individuation au fait de la transindividuation), est l’élargissement d’un circuit où est prise la Madone de Bentalha, et comme crise d’images, et cri des images, qui s’exclament comme jamais dans l’être-en-souffrance de tous cultes.
Convert est un homme de l’art, c’est à dire de l’extériorisation qui fait de l’exclamation des pulsions le désir d’une expression, qui prend soin de l’expérience et de sa clameur, par son expérience patiente et effarée des rétentions tertiaires, sans lesquelles il n’y aurait ni œuvres, ni circuits.
L’art est un faire. C’est ainsi qu’entre les souches, la cire, la revenance des images de l’histoire de l’art religieux, les photogrammes des fusillés et des victimes civiles d’hier et d’aujourd’hui, et le balayage des écrans cathodiques qui chasse toute possibilité d’une image et d’où il s’agit pourtant de réinventer une image comme on crut autrefois exhumer la Sainte Croix, il poursuit son curriculum et travaille le corps de l’histoire de cette question orpheline :
Qu’est-ce que tu fais, toi ?
Bernard Stiegler
1 - J’ai déjà abordé ce thème de l’image qui rend aveugle dans le dernier chapitre de De la misère symbolique 1. L’époque hyperindustrielle, à propos d’un film de Bertrand Bonello, Tiresia.
2 - Dans De la misère symbolique 2. La catastrophè du sensible, Galilée, 2005.
3 - Je dois ici préciser que j’ai finalement choisi d’écrire ainsi ce mot d’existance après avoir hésité puis renoncé à le faire dans Constituer l’Europe (Galilée, septembre 2005) : j’opte ici pour ce a à la suite d’un échange avec … au cours d’une réunion de l’association Ars Industrialis qui s’est tenue au théâtre de la Colline à Paris le 18 juin 2005.
4 - Je développe ce thème à partir d’Aristote dans le premier chapitre de De la misère symbolique 2.
5 - Dans De la misère symbolique 2.
/ Accueil /
Biographie / Oeuvres / Expositions / Films / Thématiques / Documents
Textes - articles / Editions / Liens - contact / Au hazard